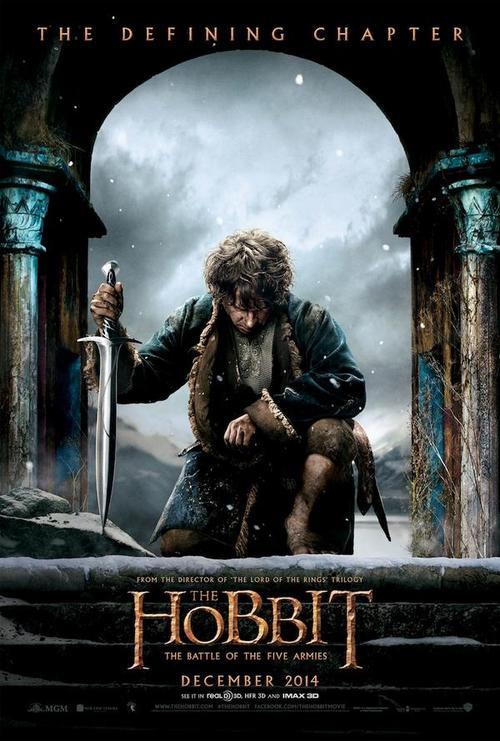Il était une fois, au détour d’un quartier grisé par l’agitation des
passants, un bâtiment de petite taille abritant derrière chacune de ses portes,
mille et une histoires projetées sur écrans blancs. Dans l’une de ces salles
obscures mercredi dernier, se trouvaient un loup affamé, une sorcière, un
chaperon rouge, une certaine Cendrillon, un jeune garçon répondant au nom de
Jack, et une demoiselle à la chevelure considérable enfermée dans une tour.
Leur point commun ? Être à l’origine des contes que la compagnie Disney s’est
appropriée pour en faire les dessins animés chéris qui ont bercés notre
enfance. Leurs interprètes ne nous sont pas moins méconnus : on compte
entre autre Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, Chris Pine et Christine
Baranski. Aujourd’hui, grâce à ce film issu d’une comédie musical du même nom,
ces personnages se rencontrent dans un seul et même conte.
Originale puisque souvent minoritaire au cinéma, la comédie musicale est
souvent déconcertante de prime abord. Il ne faudra pas questionner
leurs chants incessants et l’apparente fantaisie des actions -qui tendent vers
un rendu irréaliste au possible, pour pouvoir s’immerger complètement dans un
monde diamétralement autre. Somme toute, revenir à un état plutôt bon enfant,
encore plus nécessaire de par le fait qu’il est ici question de contes.
Néanmoins, il est à noter que le film n’est pas uniquement construit pour un
jeune public. En effet, le scénario du film est truffé de références et d’humour
implicite que seul un spectateur averti pourra reconnaître. En fait, ce film se
sait comédie musicale, et joue des codes propres à ce genre pour atteindre le
public adulte, ce que j’ai trouvé personnellement très subtile.
Cela s’illustre par exemple dans la séquence chantée en duo par le prince de Raiponce et celui de Cendrillon au sommet d’une cascade; la scène va crescendo vers l’absurde et l’autodérision de la figure du prince. D’une part, l’humour se crée par le paysage qui devient à part entière un élément comique, lorsque les princes se jettent pieds joints tour à tour dans l’eau, dans l’optique d’être faussement émouvant, alors que le rendu est tout autre à cause des éclaboussures assez enfantines. D’autre part, le comique émane évidemment des personnages eux-mêmes, par leurs expressions très théâtrales, tantôt contrites de désespoir, tantôt amourachées mais jamais surjouées, d’où la subtilité du comique. Ils accompagnent la parole de gestes exagérés, comme le fait d’ouvrir sa chemise en l’arrachant, souvent exécutés en miroir ce qui donne un aspect clownesque. Il était question de références dans l’ensemble du film ; dans cette scène, on pourra d’ailleurs noter deux références, l’une à Travolta (par les habits d’un des deux princes, et d’une gestuelle assez reconnaissable), l’autre à la danse contemporaine/d’autres comédies musicales, qui utilisent l’eau comme effet pathétique ou saisissant, pour en jouer et le détourner.
Cela s’illustre par exemple dans la séquence chantée en duo par le prince de Raiponce et celui de Cendrillon au sommet d’une cascade; la scène va crescendo vers l’absurde et l’autodérision de la figure du prince. D’une part, l’humour se crée par le paysage qui devient à part entière un élément comique, lorsque les princes se jettent pieds joints tour à tour dans l’eau, dans l’optique d’être faussement émouvant, alors que le rendu est tout autre à cause des éclaboussures assez enfantines. D’autre part, le comique émane évidemment des personnages eux-mêmes, par leurs expressions très théâtrales, tantôt contrites de désespoir, tantôt amourachées mais jamais surjouées, d’où la subtilité du comique. Ils accompagnent la parole de gestes exagérés, comme le fait d’ouvrir sa chemise en l’arrachant, souvent exécutés en miroir ce qui donne un aspect clownesque. Il était question de références dans l’ensemble du film ; dans cette scène, on pourra d’ailleurs noter deux références, l’une à Travolta (par les habits d’un des deux princes, et d’une gestuelle assez reconnaissable), l’autre à la danse contemporaine/d’autres comédies musicales, qui utilisent l’eau comme effet pathétique ou saisissant, pour en jouer et le détourner.
Dès lors qu’on s’habitue à l’univers du conte, irréaliste et fantastique,
et aux nombreuses chansons qui jalonnent les dialogues des personnages, on
accepte plus facilement l’aspect un peu simpliste des effets spéciaux. En
effet, Johnny Depp par exemple semble plus grimé en loup avec ses grandes ( fausses)
vibrisses et son chapeau hauteforme doté de deux oreilles qu’incarnant un loup.
Il n’y a pas vraiment cette volonté d’illusion à tout prix. Seule Meryl Streep porte
un maquillage qui semble être issu de plusieurs heures de travail. D’un point
de vue purement cinématographique, genre à part, le film s’avère être un peu
long, avec une coupure au milieu créant deux récits distincts et pas
nécessaires l’un à l’autre. La voix off, se voulant être la voix du conteur,
à mi-chemin entre l’ironie pas totalement assumée et la bienveillance propre
aux conteurs rend ses interventions troublantes et peu constructives. Enfin, l’enchainement
et l’encastrement des récits les uns dans les autres est assez grotesque. Mettons qu’encore une fois,
seul le genre permet d’excuser ces légères incohérences…
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants de critiques.
Jessica Crochot, L3 Lettres et Arts